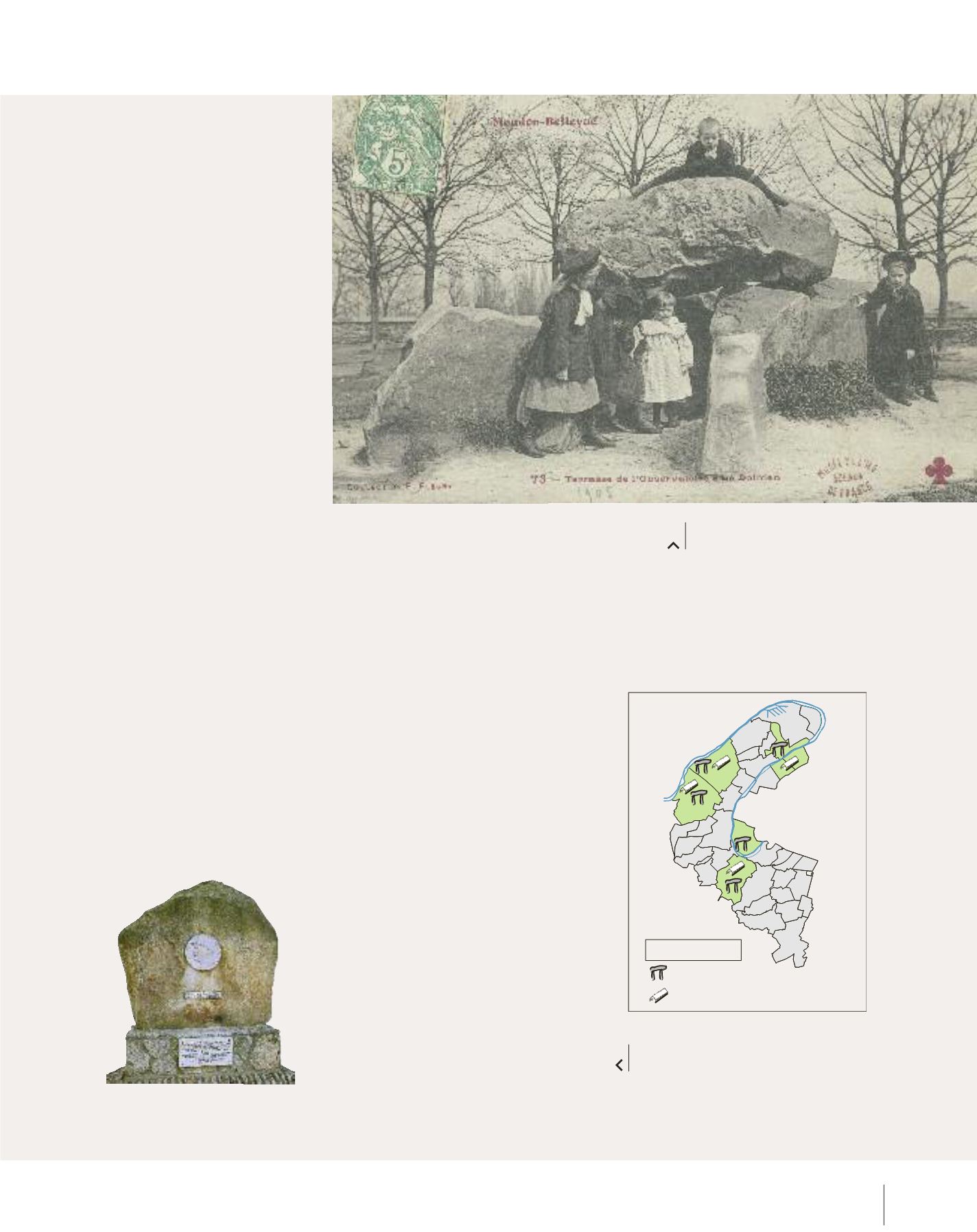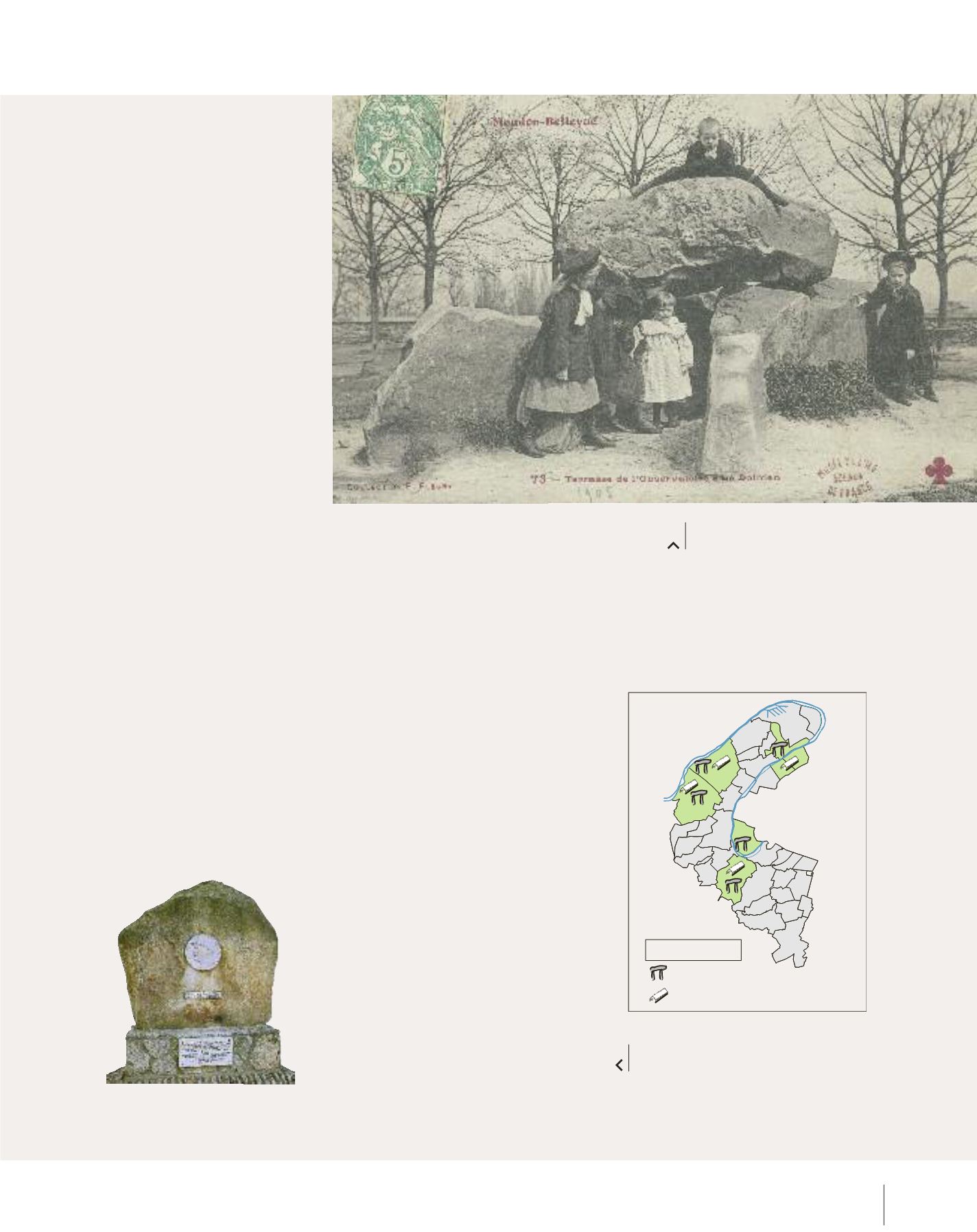
71
moins 40 centimètres. À sa base, d'au-
tres petits blocs ont été dégagés. Ils
correspondent aux pierres dites de
« calage », quimaintenaient lemenhir
vertical lorsqu'il était planté dans le sol
meuble. En tombant, lemenhir a donc
soulevé ces petits blocs, qui se retrou-
vent maintenant posés sur sa base. Au
milieu de cette dalle, une trace som-
bre est àmettre au compte d’une alté-
ration par le feu.
S’il est difficile d’interpréter cette trace,
elle permet néanmoins d'évaluer la
profondeur d'enfouissement du mé-
galithe : le feu ayant été fait au sol, seule
la partie située au-delà des indices de
chauffe dépassait de terre.
Le menhir de Rueil-Malmaison,
comme lamoitié de la cinquantaine de
ses parallèles connus d’Île-de-France,
est couché. Il présente toutefois l'inté-
rêt de reposer sur le sol d'origine, c'est-
à-dire d’être associé à des objets et à
d'autres éléments (comme les pollens)
qui lui sont contemporains. Laissé en
place à l’issue de l’opération, son po-
tentiel reste donc entier. Enoutre, avec
sa hauteur de 3,30 m, il figure parmi
les plus grands mégalithes régionaux
demême type, qui ne dépasse que ra-
rement 2,5 m.
DisParitions et aPParitions
Les documents anciens, comme les
cartes et certaines publications, men-
tionnent parallèlement des monu-
ments aujourd'hui disparus, dont
l'authenticité ne peut être prouvée.
Il existe aussi des monuments créés
de toutes pièces à l'époque moderne,
parfois à l'aide de blocs authentiques
provenant demégalithes détruits.
Parmi les mégalithes disparus ont ci-
tera notamment celui de Boulogne-
Billancourt où auraient été découverts
dans une carrière en 1866 des osse-
ments humains dans undolmen ruiné
au bord de la Seine.
Par ailleurs, si Meudon a accueilli une
authentique allée couverte, on y trouve
un bien curieux assemblage connu
sous lenomde« trilithes duChênedes
Missions » érigé par lesmissionnaires
du séminaire de Bièvres. C’est en effet
en 1895 que ceux-cimirent en place un
groupe de mégalithes composé d'un
grand menhir élancé et de quatre tri-
lithes disposés par ordre de grandeur
en arc de cercle autour dumenhir.
Enfin, au-delà de l’approche archéolo-
gique - et bien que cette approche ne
puisse s’y substituer - la toponymie
conduit parfois à supposer la présence
d'un site ou d'un monument. C’est
le cas de la rue de la Pierre-Plate à
Bagneux, de la rue des Gros-Grès à
Colombes, de la rue des Pierrelais à
Fontenay-aux-Roses et du lieu-dit « La
Pierre Plate » àMontrouge.
n
© A.Viand, service archéologique/CG92/2010
© Collection du Musée d’Ile-de-France
VILLENEUVE
LAGARENNE
ASNIERES
SURSEINE
Megalithe (menhir, allée couverte, dolmen,...)
Habitat
Vestiges néolithiques
observés, décrits ou étudiés
Asnières-sur-Seine
Nanterre
Rueil
Malmaison
Boulogne-Billancourt
Meudon
Clichy
Levallois-Perret
g q p
© A.Viand, service archéologique/CG92/2010
Bloc mégalithique
découvert en ?CAA à
Asnières, au centre du
tumulus qui recouvrait
des sépultures en
cistes.
En ?C>B, l’allée
couverte de
Meudon sur la
terrasse de
l’Observatoire.