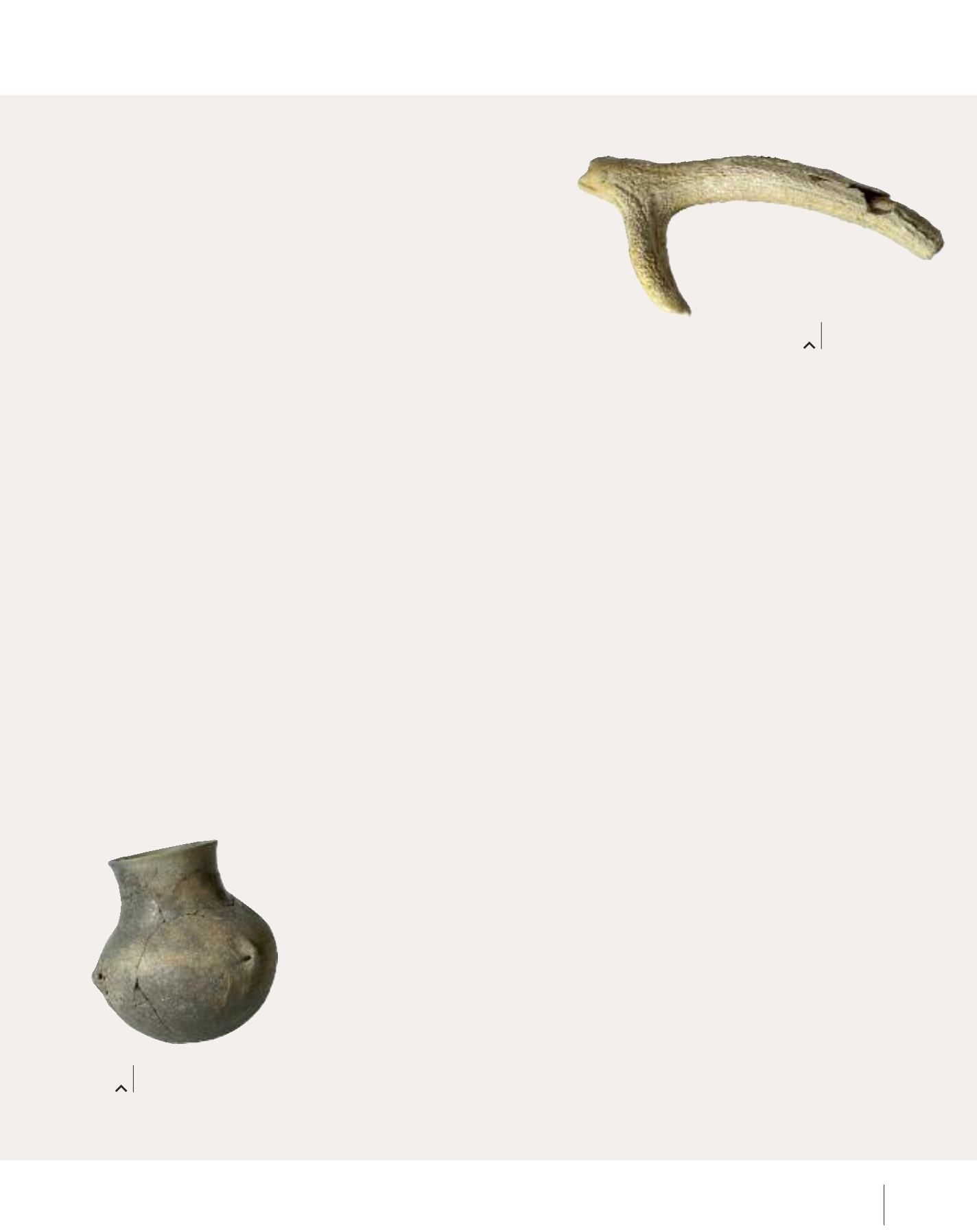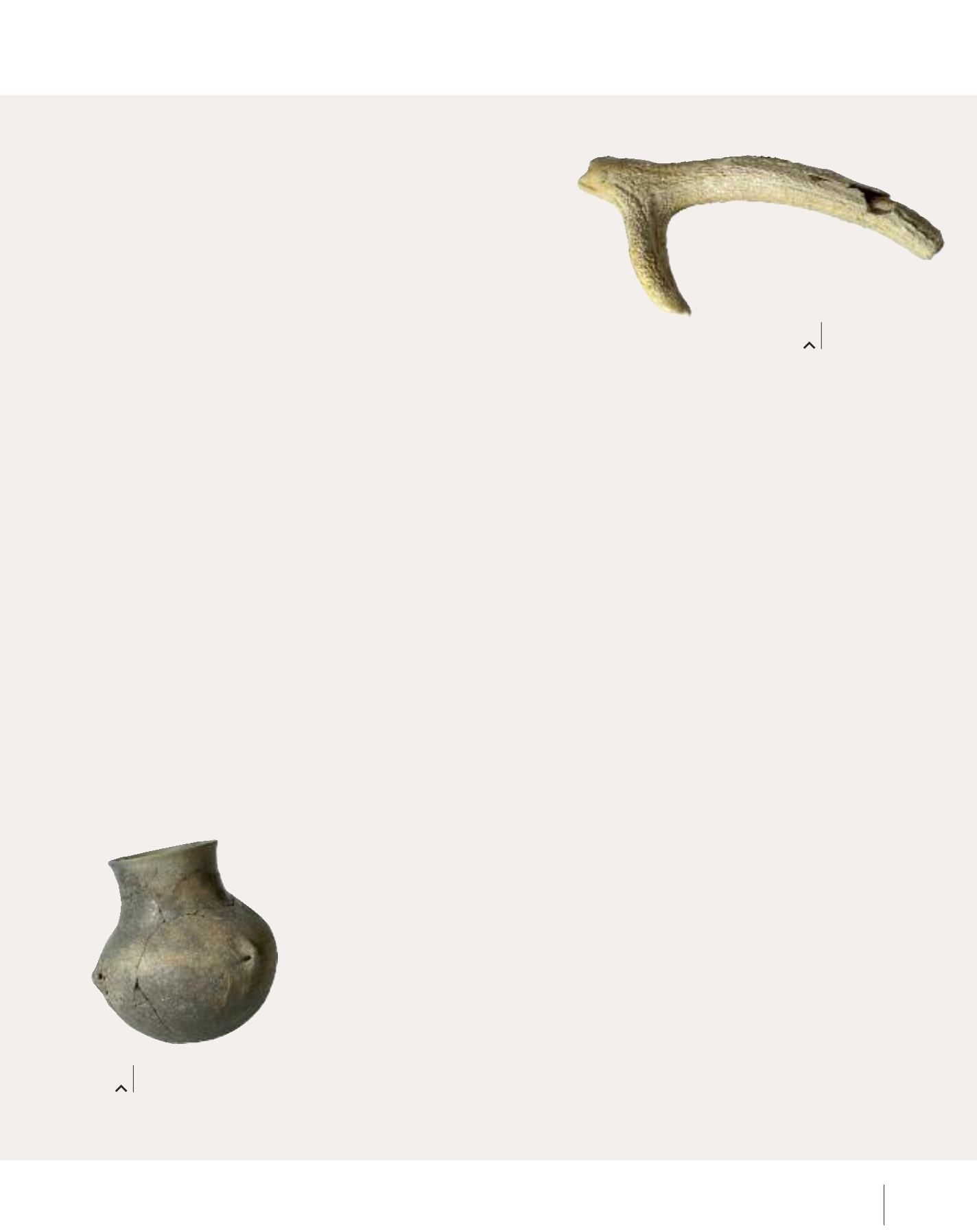
69
murs externes ne semblent pas avoir
été porteurs. À l’image d’exemples
désormais nombreux, cet édifice a pu
participer de l’un de ces petits villages
classiques du Néolithique ancien.
Toutefois, la fouille n’ayant pas été très
étendue, il demeure impossible de
déterminer le nombre de maisons de
même type construites aux alentours.
Les fouilles extensives d’habitats néo-
lithiques dans les Hauts-de-Seine
demeurant encore rares, ce sont essen-
tiellement des témoignages mobiliers
qui permettent de déterminer la pré-
sence des occupations, leur nature et
leur datation. Si les contextes de mise
au jour de ces éléments sont désormais
assurés et biendocumentés, il convient
somme toute de rester prudent dès
lors qu’il s’agit de découvertes an-
ciennes, peu ou pas renseignées et de
provenance parfois incertaine.
Outre les habitats
stricto sensu
, des sites
d’exploitation sont parfoismis au jour,
telles lesminières de silex du Brimbo-
rion, sur les hauteurs de Sèvres. Le
gisement, qui se signale par des gale-
ries horizontales quand la plupart des
exploitations se font en puits verticaux,
a livré plusieurs pics en bois de cerf,
utilisés à la manière de pioches. Ces
observations ayant été réalisées dans
un contexte urgent de sauvetage,
le contexte général de l’exploitation
demeure imprécis.
p
Audemeurant, plusieurs interventions
anciennes ont d’une certainemanière
préfiguré l’archéologie contempo-
raine, telles la fouille d’André Laville à
Meudon ou les observations d’Eugène
Belgrand à Clichy et Levallois. De 1915
à 1922, le premier a en effet observé
une douzaine de foyers et collecté plu-
sieurs centaines d'outils en pierre et de
fragments de céramiques, l’ensemble
participant manifestement des ves-
tiges d’un habitat néolithique. Le se-
cond, géologue de formation et ingé-
nieur chargé des égouts de Paris,
a porté un intérêt tout particulier aux
travaux d’extraction entrepris sur l’an-
cienne commune de Clichy-Levallois,
s’intéressant tant aux vestiges mobi-
liers qu’à leur position stratigraphique
au sein des formations alluviales. Il en
publia les résultats en 1865 dans un ou-
vrage d’une rare précision, qui permet
aujourd’hui de situer le théâtre de ces
découvertes et demesurer le potentiel
archéologique de la commune de
Levallois, par ailleurs site éponyme de
l’une des plus célèbres techniques de
débitage du silex au Paléolithique.
les Premiers monuments Des
hauts-De-seine
Lesmégalithes sont assez fréquents en
Île-de-France, notamment dans les
Hauts-de-Seine, où nombre d’entre
eux ontmalheureusement été déman-
telés à l’occasion de travaux ou utilisés
commematériaux de construction.
C’est ainsi qu’à l’occasion de travaux,
furent découvertes àAsnières, en 1933,
au moins douze sépultures en cistes
individuelles, placées autour d'une
pierre verticale évoquant un menhir.
L'ensemble, qui reposait sur un sol
dallé de pierres, était recouvert d’un
tertre de sable.
Les corps étaient placés en position
repliée - tête à l'Ouest et pieds à l'Est-
dans ces caissons constitués de dalles
plates. Les cistes, au seindesquels seuls
trois grattoirs en silex furent décou-
verts, étaient surmontées d'une autre
couche de dalles, puis d'un tumulus de
sable ferrugineux, probablement haut
d'aumoins trois mètres.
Le «menhir », quant à lui épais de 40
cm, présentait une largeur de 1,75 m
pour une hauteur de 2,25 m. Les osse-
ments et les objets furent confiés un
temps à la mairie, qui s'en débarrassa
quelques années plus tard. De ce
monument, seule demeure donc
aujourd’hui la pierre dressée, visible
dans le parc de l'Hôtel de ville.
À Nanterre, si des vestiges néoli-
thiques ont été observés à l’occasion
de fouilles récentes, c’est surtout la re-
présentation d’un cercle de pierres qui
retient l’attention.
En effet, un tableau du
xVII
e
siècle inti-
tulé « Sainte Geneviève gardant son
troupeau », conservé au musée Car-
navalet, représente la sainte du
V
e
siècle
au milieu de ses moutons dans l’en-
ceinte d’un très vraisemblable crom-
lech. Si l'on en juge par la toponymie,
la scène peut être située au lieu-dit
« Parc Sainte-Geneviève », ancienne
enclave de Nanterre sur la commune
de Rueil-Malmaison. Outre cette
unique représentation figurée, divers
auteurs des
xVII
e
et
xVIII
e
siècles ont fait
mention de cemonument dont l'exis-
tence est signalée dès I608, mais dont
on ignore la date de destruction.
C’est en 1845, lors de travaux, que furent
dégagées plusieurs grosses pierres à
Meudon. Elles étaient connues depuis
le
xVII
e
siècle, et l'une d'elles portait
même le nom de « Pierre de Rabe-
lais ». Lors du démontage de cet en-
semble, apparurent d'autres dalles de
grès et de nombreux ossements hu-
mains. À la suite des dégradations per-
pétrées en 1805 puis en 1820, certaines
de ces dalles furent alors débitées en
pavés. Des fouilles furent cependant
improvisées, permettant de dénom-
brer les restes d'au moins deux cents
individus (hommes, femmes, enfants et
individus âgés) accompagnés d'objets
© Cliché G. Vannet / CG92 / 2010
Vase découvert
à Rueil-Malmaison
Néolithique ancien
Pic d’extraction
en bois de cerf.
Minières de silex
du Brimborion
© Cliché G. Vannet / CG92 / 2010