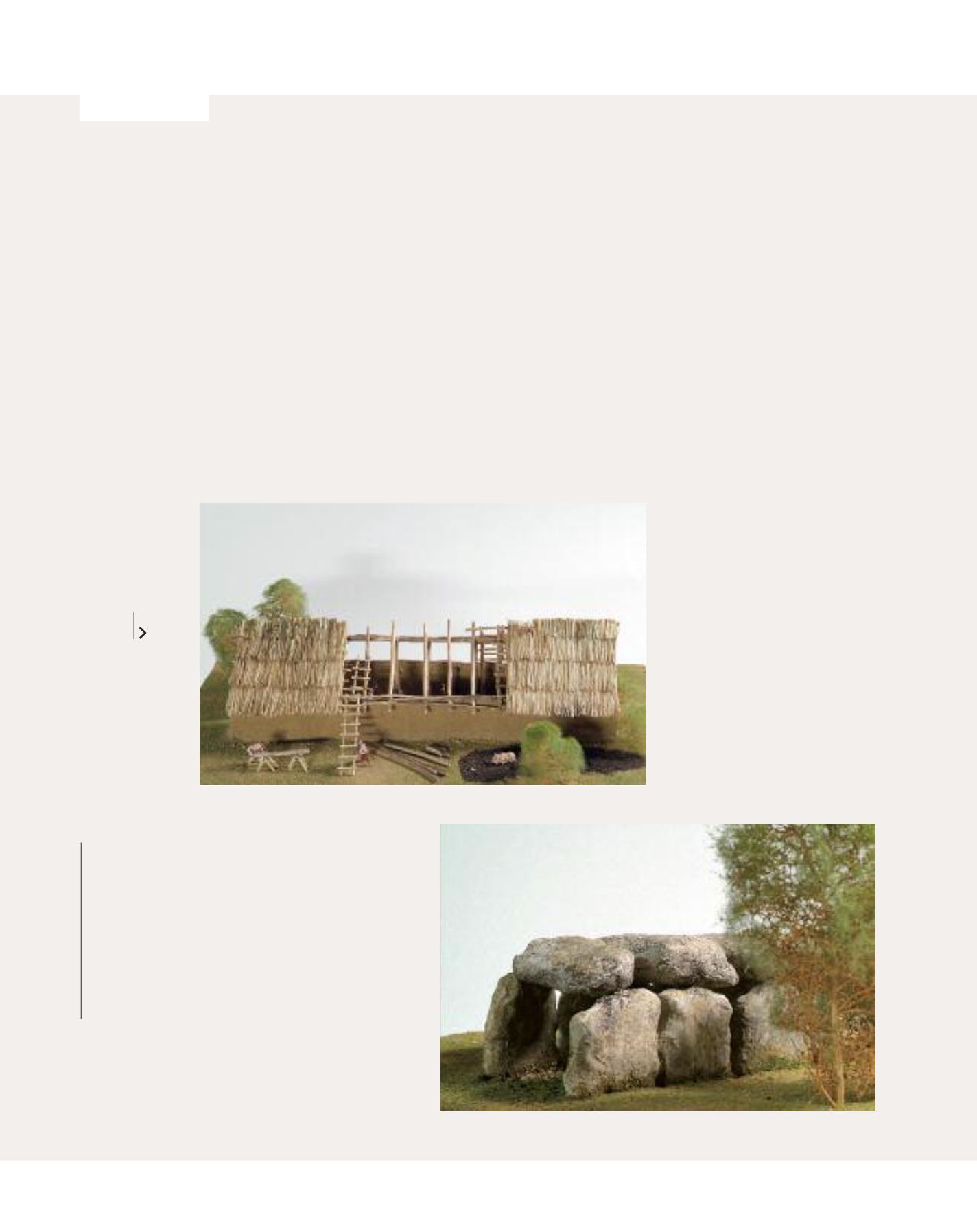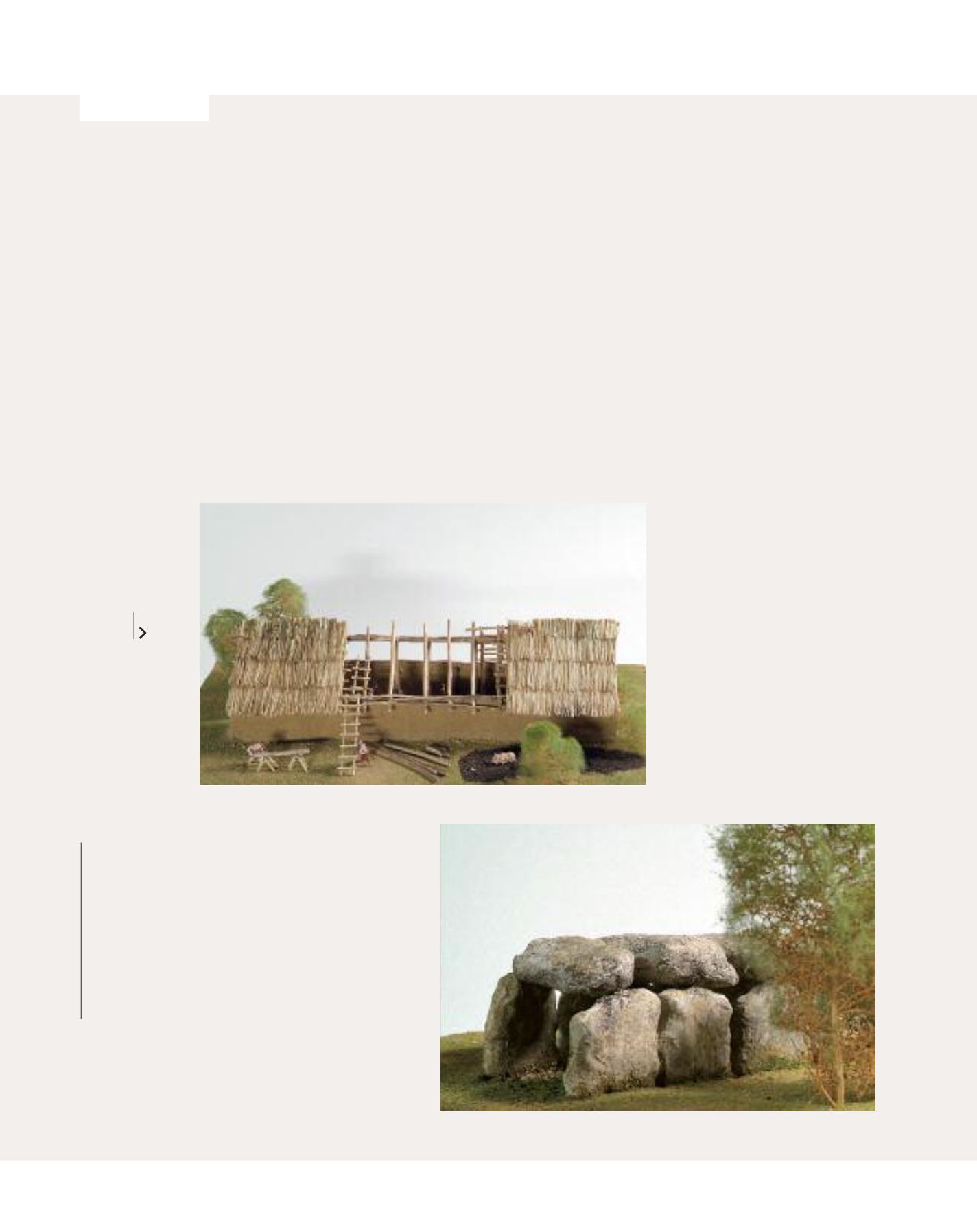
70
divers. À l’époque, ce sont surtout les
crânes qui retinrent l'attention des
chercheurs, soucieux de déterminer
des caractéristiques biologiques. Ces
crânes ont été répartis entre le musée
de la Faculté de Médecine, le musée
Carnavalet et le musée d'Archéologie
Nationale, à Saint-Germain-en-Laye.
Des haches polies, des pointes de
flèches, des outils enos (poinçons), des
objets de parure (collier de dents, pen-
dentifs en schiste) et de nombreux
fragments de poteries ont par ailleurs
été collectés puis déposés aumusée de
l'Homme et aumusée Carnavalet.
À l’issue des fouilles, les blocs restants
furent transportés jusque dans la cour
du château de Meudon puis disposés
en forme de pyramide en 1861, laquelle
fut détruite par les troupes allemandes
en 1870. On peut actuellement voir le
dolmen sur laTerrasse duChâteau, où
il ne ressemble que de loin au monu-
ment d'origine. Celui-ci adoptait vrai-
semblablement la forme d’une allée
couverte d'environ treize mètres de
long, orientée auNord-Nord/Est, c’est-
à-dire dans le sens de la pente du
terrain. À l'intérieur, cette chambre
mesurait probablement près de dix
mètres de long pour une largeur de
deux mètres et une hauteur de 1,50
mètre. Cette allée reposait sur une
assise de pierres sèches, qui constituait
la fondation dumonument. Les côtés
étaient formés degrandes dalles reliées
entre elles par des murets de pierres
sèches. Au-dessus, au moins cinq
grandes dalles auraient assuré la cou-
verture de l'allée, tandis que le sol était
pavé de plaquettes de calcaire.
Toutes les dalles utilisées étaient en
grès de Fontainebleau, roche dont il
existe des gisements dans la forêt de
Verrières, non loin de Meudon. Trois
d'entre elles au moins étaient ornées
de rainures, de trous ou de cupules.
À Rueil-Malmaison, c’est à l'occasion
de la construction de l'autoroute A86
qu’unmenhir fut découvert lors d'une
fouillearchéologique,en1994.Leméga-
lithe reposait à plat, sur une ancienne
berge de la Seine, à une profondeur
d'environdeuxmètres sous le sol actuel.
Ce menhir était à l'origine haut de 3,3
mètres, large de 1,6mètre et épais d'au
ARCHÉOLOGIE
Hauts-de-Seine
À noter
Première d’une série thématique
et chronologique, la mallette pédagogique
« Le Néolithique dans les Hauts-de-Seine »
sera bientôt proposée aux établissements
scolaires du département. Fiches
synthétiques, notices mais aussi
fac-similés et maquettes permettront
ainsi au jeune public de mieux connaître
le patrimoine archéologique des Hauts-
de-Seine à la lumière de généralités sur
la période.
Renseignements :
archeologie@cg+*.fr
« Entre la fin de la Préhistoire
et les âges des métaux,
soit quatre millénaires,
le Néolithique est une période
de mutations sans précédent.
La sédentarisation et donc
l’architecture, mais aussi
l’élevage, l’agriculture,
le tissage, la poterie sont
autant d’avancées majeures. »
© Réalisation Nakara, Cliché G. Vannet / CG92 / 2010 /
© Réalisation Nakara, Cliché G. Vannet / CG92 / 2010
Évocation
de la maison
néolithique à Rueil-
Malmaison
(ci-contre)
Évocation de l’allée
couverture de Meudon
(ci-dessous)