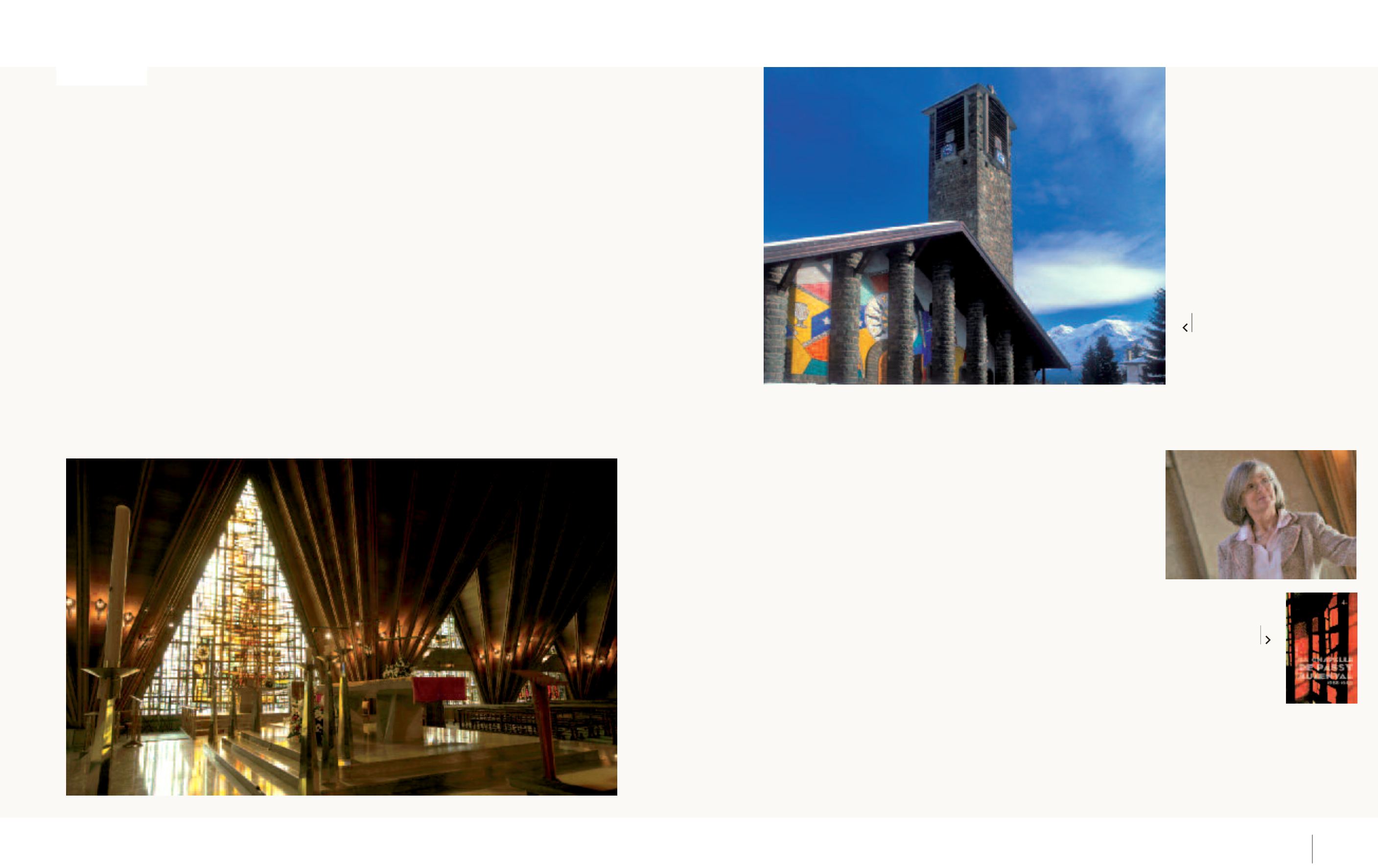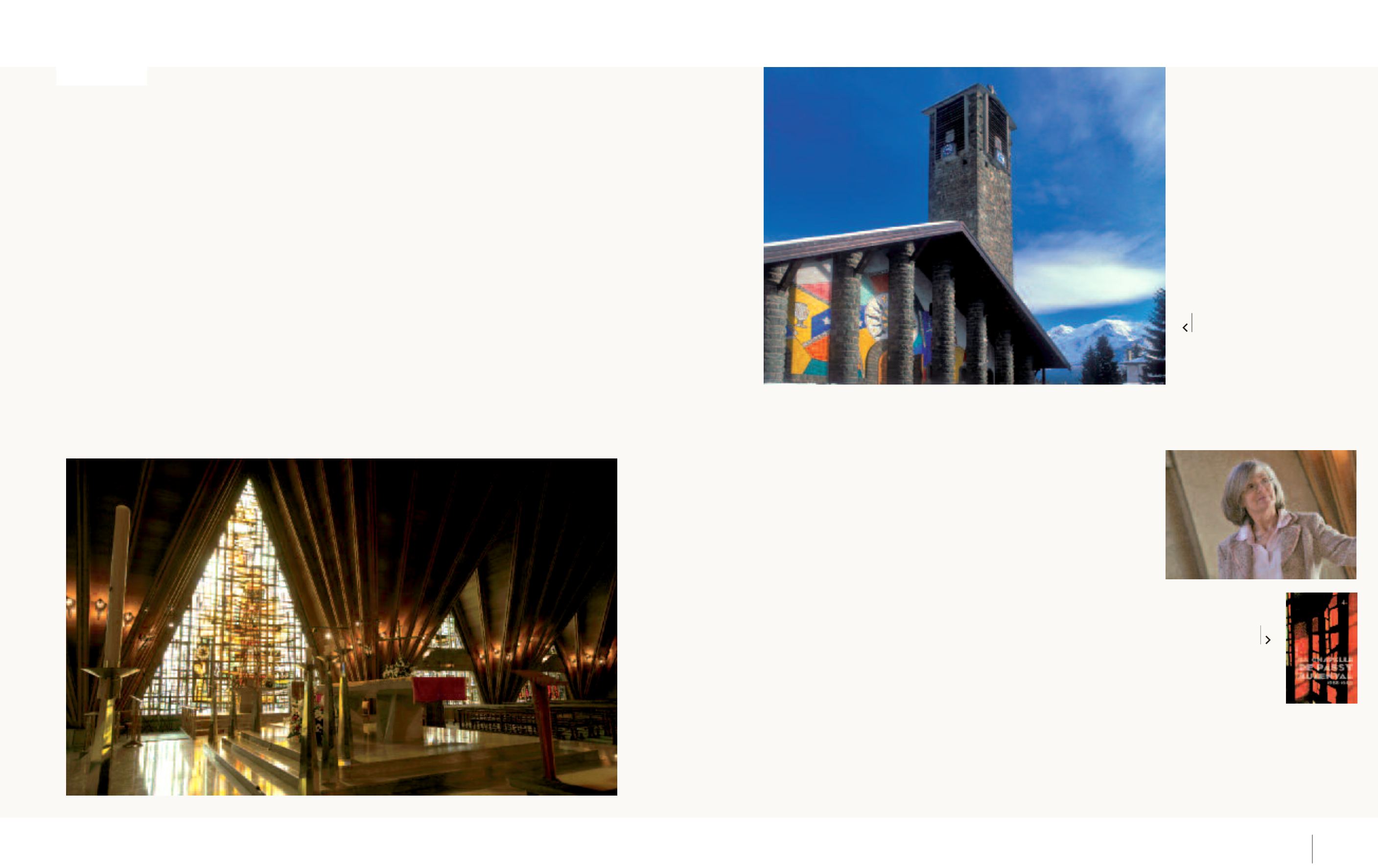
65
64
LaGrandeChapelles’inscritdanslemou-
vement d’art chrétienmoderne du siècle
dernier. Voici ce qu’en écrit Dominique
de La Rivière dans son ouvrage
La Cha-
pelle de Passy-Buzenval
. Extrait.
«Lemouvement d’art chrétienmoderne
naît en 1923 en France àNotre-Dame du
Raincy lorsque Auguste Perret utilise,
pour la première fois dans une église, le
bétonbrut de décoffrage sans chercher à
en dissimuler le grain qui apparaît dans
toute sa vérité. Au lendemain de la se-
conde guerremondiale, la vision de l’art
sacré, dont certains principes esthétiques
ont déjà étémûrement pensés parMau-
rice Denis et mis en œuvre par Maurice
Novarina à Notre-Dame de toute grâce
à Assy, peut s’exprimer librement grâce
aux grands chantiers de la reconstruction
ainsi qu’à un désir de réconciliation en-
tre l’Église et l’art moderne. La profonde
mutation qui s’opère s’exprime par une
libérationdes formes et des schémas aca-
démiques. Époque bénie pour une géné-
ration d’architectes pour qui un chantier
d’église est une expérience unique, celle
de transcrire architecturalement lesmys-
tères de la foi. Ils profitent donc de cette
période pour imaginer des formes nou-
velles pour des programmes inédits.
Matisse, Le CoRbusier, BRaque…
La décennie 1950-1960 voit émerger une
nouvelle génération d’architectes qui
s’investissent avec passion dans l’art
sacré tels Mies Van der Rohe aux États-
Unis, Alvar Aalto en Finlande, Oscar
Niemeyer au Brésil. En France, Matisse
à la chapelle duRosaire deVence, LeCor-
busier à Notre-Dame de Ronchamp,
Perret à Saint-Joseph du Havre, Gillet à
Notre-Dame de Royan mettent leur
talent au service de monuments excep-
tionnels (…)
Ces architectes redécouvrent la beauté
des volumes simples dans leplanet la vo-
lumétrie et s’octroient une entière liberté
de formes d’oùune grande libertéde réa-
lisations allant de l’esthétique brutaliste
à unemodernité plus classique. Époque
bénie aussi pour une génération de
peintres et de sculpteurs qui revivifient
le décor de ces églises. Les pères domi-
nicains Couturier et Régamey, direc-
teurs de la revue L’Art sacré, appellent
les maîtres de l’art vivant à participer au
renouveau de l’art religieux catholique
jugé « moribond » car mièvre et aca-
démique. Ils parient sur le génie d’ar-
tistes, fussent-ils athées, commeGeorges
Braque àVarengeville ou Fernand Léger
à Audincourt, plutôt que sur les artistes
croyants traditionnels, jugés mièvres. «
En eux abondent la vie et ses dons ; il faut
parier sur ceux qui par nature et par tempé-
rament, sont préparés ou prédisposés aux in-
tuitions spirituelles. Il faut parier sur le gé-
nie et croire aumiracle
».
Des commandes sont passées à ces
grands maîtres renouant un fil inter-
rompu pendant plus d’un siècle. «
Se
libérer du solennel sans pour autant le dé-
truire. Aux grands hommes, les grandes
œuvres, tel est leur credo
». La référence
exemplaire est l’église d’Assy. Autour de
l’architecte Novarina, une pléiade d’ar-
tistes conjuguent leurs talents au service
d’uneœuvre résolument innovantemais
controversée en raisonnotamment de la
figure du Christ de Germaine Richier.
PATRIMOINE RELIGIEUX
Rueil-Malmaison
Le Renouveau de l’aRt religieux catholique :
« PaRieR sur le géNie et cRoiRe au MiRacle »
« La décennie 1950-
1960 voit émerger
une nouvelle génération
d’architectes qui
s’investissent avec
passion dans l’art sacré. »
Dominique de La Rivière,
auteur de
La chapelle
de Passy-Buzenval –
1955-1960,
éditions Nicolas-
Chaudun, 192 pages, 32
euros.
(disponible aussi au
secrétariat du collège).
Le produit de la vente est
intégralement reversé à
l’entretien de la chapelle.
Les délicates fRoNtièRes
de l’aRt sacRé
Mais l’autorité ecclésiastique française
«
inquiète de l’incompréhension croissante
qui sépare une élite cultivée de la plus grande
partie des fidèles, prend majoritairement
partie pour un art liturgique modérément
réformé, à mi-chemin de l’art de Saint-Sul-
pice et de celui prôné par la revue l’Art sacré.
»
Dans cette querelle, le Saint-Siège va
même jusqu’à affirmer qu’il ne faut
confier les créations artistiques dans
l’Église «
qu’à des hommes qui soient
capables d’exprimer une foi et une piété
sincères
». Tout cela vient briser durable-
ment ce renouveau, ce qui explique que
dans la décennie suivante, l’architecture
prend le pas sur les arts plastiques.
L’abstraction se substitue à l’expression-
nisme. Les églises se voient dépouillées
de leurs ornements, épurées sous pré-
texte de puritanisme formel, s’opposant
ainsi audécor sulpiciendes constructions
précédentes.Afind’éviter que les lieux de
culte ne deviennent des espaces vides et
froids, ce qui a parfois été le cas, le vitrail
reprend alors une grande importance,
contribuant à créer une ambiance cha-
leureuse et favorable à la prière ».
n
(Les intertitres sontde la rédaction)
La chapelle de Toute
Grâce de Notre-Dame
d’Assy (ville de Passy),
face au Mont-Blanc.
La figure du Christ
de Germaine Richier
suscita la polémique.
© Savoie Mont Blanc / Berger
© CG92/Willy Labre
© CG92/Willy Labre